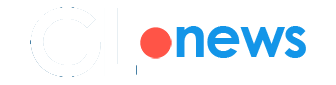![[Tribune] La Constitution de 2006 n’a pas échoué (Olivier Kamitatu)](/media/posts/6996edda7d7ec352342930.jpg)
Il y a vingt ans jour pour jour, dans l'enceinte solennelle du Palais du Peuple, le président Joseph Kabila promulguait la Constitution de la République Démocratique du Congo.
À ses côtés, le président Thabo Mbeki d’Afrique du Sud et le président Denis Sassou-Nguesso du Congo-Brazzaville, alors président en exercice de l’Union africaine, étaient venus rehausser de leur présence ce moment historique.
Je m’en souviens comme d’un matin de résurrection. Le Congo enterrait ses démons. Le Congo naissait à nouveau.
Ce texte n’était pas un document de juristes. C’était un traité de paix entre les Congolais.
L’acte notarié d’un serment prononcé à Sun City, où des ennemis avaient choisi de devenir des concitoyens.
Et ce serment, scellé par le vote de 84,31 % des Congolais lors du référendum des 18 et 19 décembre 2005, porte une légitimité que nul pouvoir — fût-il armé — ne peut défaire sans se condamner lui-même.
J’en parle en témoin. J’en parle en acteur. J’ai eu l’honneur de présider l’Assemblée nationale de transition qui a conduit les débats précédant l’adoption de ce texte par le peuple.
Je mesure, à cet anniversaire, la distance vertigineuse entre ce que nous avions rêvé et ce que nous avons obtenu.
Mais je mesure aussi, avec la même certitude, que la promesse constitutionnelle demeure la seule boussole capable de sortir notre pays de l’abîme.
Le diagnostic que le peuple s’est posé à lui-même
Il faut relire le préambule. Pas comme un exercice académique, mais comme un acte d’introspection nationale.
Car il est rare qu’un peuple dise de lui-même, dans sa loi fondamentale, les mots que les Congolais ont accepté de graver dans le marbre.
Le préambule de la Constitution du 18 février 2006 pose un diagnostic d’une lucidité impitoyable.
Il identifie les maux du Congo avec la précision d’un chirurgien : « l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme » — et il ajoute que ces fléaux sont « à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ».
Ce diagnostic n’a pas vieilli. Il est même devenu, vingt ans plus tard, d’une troublante actualité.
Mais ce qui fait la grandeur de ce préambule, c’est qu’il ne se contente pas de nommer le mal.
Il prescrit le remède : un État de droit, une démocratie politique, économique, sociale et culturelle, et des institutions dont la légitimité procède du peuple souverain.
L’exposé des motifs va plus loin encore. Il formule ce que tout le monde savait sans oser le dire : « Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. »
Voilà le mot qui traverse toute l’histoire congolaise comme un fil rouge sanglant : la légitimité. Ou plutôt son absence.
C’est la crise de légitimité qui a engendré Mobutu. C’est la crise de légitimité qui a nourri les deux guerres.
C’est la crise de légitimité qui, vingt ans après la promulgation de cette Constitution, continue de gangréner la République.
Ce que la Constitution portait en elle
Le texte de 2006 n’est pas n’importe quelle constitution. C’est la première de notre histoire qui procède véritablement d’un consensus national négocié et validé par le peuple.
Les constitutions antérieures — celle de Luluabourg, la Constitution révolutionnaire de Mobutu révisée dix-sept fois, l’Acte constitutionnel de la transition — avaient toutes été soit imposées, soit négociées dans un cercle restreint.
Le constituant de 2006 a fait des choix d’une audace considérable.
Il a instauré un semi-présidentialisme dans lequel le Premier ministre, issu de la majorité parlementaire, conduit la politique de la Nation — formule qui tranche avec la tradition de la toute-puissance présidentielle.
Il a constitutionnalisé la décentralisation, en fixant à 40 % la part des recettes nationales revenant aux provinces — un chiffre gravé dans le marbre, parce que l’expérience avait montré que Kinshasa ne redistribuait jamais volontairement.
Il a érigé l’indépendance du pouvoir judiciaire au rang de principe constitutionnel, avec trois juridictions suprêmes distinctes.
Il a consacré un catalogue de droits fondamentaux d’une ampleur remarquable, où le caractère sacré de la personne humaine côtoie le droit à l’éducation, à la santé, à la représentation équitable des femmes.
Et surtout, le constituant a posé le verrou de l’article 220 — cette clause d’éternité qui soustrait à toute révision la forme républicaine de l’État, le nombre et la durée des mandats présidentiels, l’indépendance judiciaire, le pluralisme politique.
Le peuple congolais, en adoptant ce texte, a dit à ses dirigeants : ceci, vous n’y toucherez jamais.
Vingt ans de trahison
Il faut le dire sans détour : la Constitution de 2006 n’a pas échoué. Ce sont ceux qui devaient l’appliquer qui ont trahi.
La Constitution promet la séparation des pouvoirs. Les régimes successifs ont pratiqué la confusion des pouvoirs.
La Constitution garantit 40 % des recettes aux provinces. Les provinces reçoivent moins de 10 %.
La Constitution proclame le caractère sacré de la personne humaine. Le régime répond par les massacres, la misère et l’impunité.
La Constitution institue un Premier ministre qui conduit la politique de la Nation. La pratique en a fait un auxiliaire docile de la présidence.
Nous avons une Constitution de grande démocratie et une gouvernance de petit despotisme.
Le problème n’est pas le texte. Le problème, c’est l’homme qui a juré de le respecter et qui s’en est affranchi.
Vingt ans après, la RDC croupit dans le rang des nations les plus pauvres du monde.
Elle appartient au club des pays fragiles traversés par des conflits récurrents. Elle se trouve au cœur de la confrontation des grandes puissances qui convoitent ses minerais stratégiques.
L’Est du pays brûle. Les budgets sont détournés. Les institutions sont dévoyées. Et le peuple, lui, continue de payer de son sang le prix de la trahison de ses élites.
Les velléités mortifères
Il faut aussi rappeler que la Constitution a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat politique.
La seule modification qui a abouti date de 2011 — et elle a, entre autres, supprimé le second tour de l’élection présidentielle, affaiblissant d’un trait de plume la légitimité démocratique du scrutin suprême.
En 2015, lorsque le président Kabila a laissé entrevoir son intention de se maintenir au-delà de ses deux mandats, nous avons été sept — le G7 — à dire non, de l’intérieur même de la majorité présidentielle.
J’ai été révoqué de mes fonctions de ministre du Plan pour avoir rappelé ce que le peuple avait décidé par référendum. Ce fut un honneur.
Pierre Lumbi, à l’époque Conseiller spécial en matière de sécurité, le fut aussi. D’autres comme Charles Mwando, Dieudonné Bolengetenge, Jean-Claude Kibala, Sama Lukonde, Moïse Katumbi ont démissionné librement.
Les dernières velléités de changement constitutionnel ont été plus brutales encore. Elles ont conduit des jeunes Congolais dans les rues — des jeunes qui n’avaient ni privilèges ni gardes du corps, rien d’autre que leur courage et leur foi dans la promesse républicaine.
Certains y ont laissé leur vie. Rossy Tshimanga, Thérèse Kapangala et tant d’autres sont tombés pour que l’article 220 reste debout.
Celui qui veut changer la Constitution de 2006 ne veut pas améliorer la République. Il veut se débarrasser des limites que la République lui impose.
On ne change pas les règles du jeu quand on a perdu la confiance du peuple. On rend les clés.
Un clin d’œil à l’histoire
Je veux, en cet anniversaire, adresser un mot à Joseph Kabila. C’est lui qui, le 18 février 2006, a promulgué cette Constitution devant la Nation rassemblée.
En apposant sa signature au bas de ce texte, il a donné au Congo son acte de naissance démocratique. Il fut grand ce jour-là.
Il fut grand, aussi, lorsque — après avoir caressé la tentation de se maintenir au pouvoir au-delà du terme constitutionnel — il a entendu le refus du peuple et n’a pas forcé le destin.
D’autres, sur ce continent et ailleurs, ont fait ce choix funeste. Lui ne l’a pas fait. Et ce renoncement, quelles qu’en aient été les circonstances, mérite d’être inscrit à son crédit.
Il peut l’être une troisième fois. En prêtant aujourd’hui sa voix et son poids politique à ceux qui veulent remettre le Congo sur les rails — en exigeant le respect intégral de la Constitution, en œuvrant à une solution aux causes profondes de la crise congolaise, en contribuant à ramener la paix dans un pays qui n’en peut plus de saigner.
L’histoire offre rarement trois occasions d’être grand. Celle-ci est devant lui.
Et maintenant ?
Vingt ans. C’est l’âge de la majorité. Et la question n’est plus de savoir si la Constitution est bonne ou mauvaise. Elle est bonne.
Imparfaite, certes — quel texte ne l’est pas ? — mais bonne dans ses principes, audacieuse dans son architecture, visionnaire dans ses protections.
La question est de savoir si nous aurons enfin le courage collectif de l’appliquer.
Appliquer la Constitution, c’est rétrocéder aux provinces les 40 % qui leur reviennent de droit.
C’est faire du Premier ministre le véritable chef du gouvernement, et non un exécutant révocable au bon plaisir du palais.
C’est garantir l’indépendance effective du pouvoir judiciaire. C’est organiser des élections dont la légitimité ne soit plus contestée dès le lendemain du scrutin.
C’est faire de l’article 16 — le caractère sacré de la personne humaine — une réalité vécue et non une abstraction littéraire.
Le préambule de notre Constitution dit que nous sommes « un peuple uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ».
Ces mots ne sont pas un vœu pieux. Ils sont un programme. Ils sont une feuille de route. Ils sont le Congo tel qu’il peut être, tel qu’il doit être.
La tâche qui nous attend n’est pas de réécrire le texte. Elle est de le remettre debout.
En vingt ans, on n’a pas changé la Constitution. On a simplement cessé de la respecter.
La Constitution de 2006, on ne la change pas. On l’applique.
Par Olivier Kamitatu